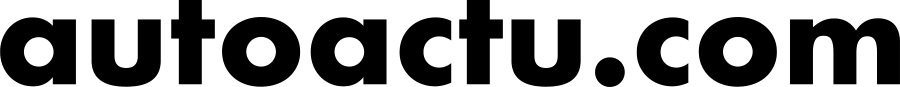20/02/2025 - #Renault
Six pot and the city
Par Jean-Philippe Thery

Aujourd’hui, je vous emmène en ville pour une balade motorisée. Enfin, j’essaye…
"Il faut rendre la ville à ses habitants."
Je tombe régulièrement sur cette injonction, qui m’a toujours semblé un peu malsaine. Remplacez en effet "ville" par "pays" ou par le nom d’un Etat, et vous obtenez un slogan prêt à l’emploi pour le genre de leader politique à propos desquels les promoteurs-même de la "restitution urbaine" seraient les premiers à pousser des cris d’orfraie. Il faut donc croire que c’est une question de taille, et qu’une formule aux relents nationalistes à l’échelle d’un Etat peut se draper de la vertu écologiste quand ramenée à la superficie d’une commune. Il n’en reste pas moins que quelque soit l’aire géographique, il est question de désigner un ennemi extérieur pour mieux le contenir hors les murs, quand il ne s’agit pas carrément de le repousser.
Voilà pourquoi nos chères automobiles ne sont plus sexy en ville, quel que soit le moteur dont elles disposent, même si je n’ai pu m’empêcher de faire allusion au 6 cylindres -ou "six pot" comme disent nos amis anglo-saxons- en guise d’accroche. Certains chroniqueurs sont décidément prêts à tout pour un bon titre... Quoiqu’il en soit, déclarées "machina non grata" dans un nombre croissant de communes, nos compagnes motorisées y subissent le rétablissement de l’octroi sous la forme d’un stationnement aux tarifs parfois proprement délirants, pouvant atteindre pour une journée dans la capitale l’équivalent d’une mensualité du crédit servant à les financer. Un principe pas social pour deux sous (et même beaucoup plus) inauguré il y a 20 ans dans une Europe à laquelle elle appartenait encore par la Grande-Bretagne, avec la "congestion charge" londonienne, dont le tarif qui n’a eu cesse d’évoluer atteint désormais les 15 livres par journée. Imaginez la joie des propriétaires d’Aston-Martin à voir ainsi la ville débarrassée des indigents qui, ne disposant pas des moyens de consacrer l’équivalent d’une heure et demi par jour de salaire minimum à la circulation urbaine, leur ont libéré la voirie.
Et pourtant, c’est bien en ville qu’est née l’automobile. Tenez, rappelez-vous à titre d’exemple le fameux pari de la rue Lepic que Louis Renault remporta au soir du réveillon de 1898 en triomphant de la pente montmartroise au volant de sa voiturette. Une machine dont le modeste monocylindre de Dion-Bouton n’aurait jamais réussi à la hisser jusqu’à la place du Tertre, si ce n’était l’efficacité de la transmission à prise directe dont Louis était l’inventeur. Convaincus par la démonstration, les douze convives venus faire bombance avec les frères Renault dans un restaurant de Pigalle signèrent les débuts de la marque en passant commande de leur exemplaire. Certes, l’auto chercha aussi très tôt à fuir la cité, comme lorsque Bertha Benz quitta Mannheim au matin du 5 août 1888 aux commandes du tricycle mis au point par son Karl de mari. Mais c’était pour mieux en rejoindre une autre, en l’occurrence Pforzheim, distante de 105 km. Un exploit sans lequel notre homme n’aurait sans doute pas inventé l’industrie automobile.
Et pour revenir de ce côté-ci du Rhin (ou plutôt du vôtre puisque je vous écris de Berlin), la géographie des tout débuts de la voiture automobile française égrène comme autant de preuves le nom des différentes métropoles de l’Hexagone. C’est à Paris que sont apparus des constructeurs tels que Citroën, Panhard ou Delahaye, les Hauts de Seine voyant notamment l’éclosion de Delage, Renault, Simca ou Sizaire-Naudin. Lyon n’était pas en reste avec Berliet, Luc Court, Cottin-Desgouttes ou Rochet-Scheider alors que les Marseillais citeront fièrement Léon Paulet ou Turcat-Méry. Et encore ne s’agit-il que d’un pot-pourri de ce que la France comptait de constructeurs automobiles à la veille de la Première Guerre mondiale, puisqu’on n’en dénombrait alors plus de 150.
Et bien entendu, c’est aussi en ville que sont apparus les aléas de la circulation. Mais de ce point de vue l’automobile n’a rien inventé, puisqu’au premier siècle après Jésus-Christ, le poète Juvénal relatait déjà les dangers encourus par l’infortuné piéton face à la multitude de véhicules circulant dans Rome. Et ce une bonne centaine d’années après que Jules César eu promulgué une ordonnance qui interdisait la circulation dans le centre-ville entre 6h à 16h. Quelques siècles plus tard, c’est également par ordonnance que François 1er tenta de "réguler la vitesse" à Paris, afin de mettre un terme aux "heurts et rivalités" qu’elle provoquait, même s’il est permis de douter que l’humanisme de la Renaissance ait soudainement apaisé les esprits des "conducteurs" de l’époque.
Ça ne s’était en tout cas pas arrangé en 1790, lorsque fut publié de façon anonyme un ouvrage broché imprimé sur papier bouffant intitulé "pétition d’un citoyen ou motion contre les carrosses et cabriolet". Son auteur, dont l’identité ne sera jamais révélée, indiquait pourtant posséder lui-même "une voiture, un cabriolet et quatre chevaux", mais se déclarait prêt à les sacrifier sur "l’hôtel de la patrie" pour peu que l’Assemblée nationale eût adopté l’interdiction des voitures hippomobiles qu’il préconisait dans son pamphlet. Il faut dire que passées de 300 à 20.000 durant le XVIIIe siècle dans la capitale française, les voitures de plus en plus légère atteignent volontiers 50 km/h sous les ordres de cochers aux manières pour le moins brutales, sans la moindre considération pour des citoyens piétons relégués au barreau le plus bas sur l’échelle sociale la mobilité urbaine. D’autant plus qu’il faudrait à ces derniers patienter encore plusieurs années avant de profiter véritablement de trottoirs qu’on venait de réinventer, après qu’on les eût oubliés depuis l’Antiquité.
Il faut dire que l’empreinte au sol des berlines, fiacres ou bagnoles (une forme de calèche) de l’époque était autrement plus imposante que celle des plus volumineux de nos SUV actuels, et a fortiori de nos citadines motorisées (vous savez, ces voitures conçues pour la ville). Et surtout, parce qu’ils étaient l’apanage des plus nantis, la domination qu’exerçaient leurs véhicules dans les rues de la ville semant la terreur parmi ceux qui usaient leurs fonds de chausse pour se déplacer -quand ils avaient la chance d’en être pourvus- relevant semble-t-il bel et bien du mépris de classe, bien qu’en pleine période révolutionnaire. Ce que reconnaissait sans doute implicitement l’auteur de la pétition comme une forme de repentance -même à visage couvert- et dont on comprend bien qu’il était de ceux qui tenaient le haut du pavé, quand bien même le foulait-il rarement.
Autres temps, autres mœurs, et de nos jours, ce sont les impécunieux qui roulent en voiture. Une classe motorisée venue de périphéries parfois distantes à qui on fait régulièrement comprendre à quel point ils ne sont pas les bienvenus dans ces centres ville qu’ils n’ont pas les moyens d’habiter. Surtout au volant de leurs machines souvent plus âgée que la moyenne du parc (de 11,2 ans en janvier 2024), ne répondant pas forcément aux "crit’air" discriminatoires plébiscités par certains édiles d’en deçà des périphs. Des automobilistes par obligation plus que par vocation, volontiers traités d’"addicts à la bagnole" quand nombre d’entre eux rêvent d’une offre de transport public qui leur permettrait de laisser Titine au garage, mais que l’on somme de rejoindre leur lieu de travail à draisienne ou en patinette. "Ils le peuvent puisque je le fais" ne manqueront pas d’ajouter doctement ceux qui chaque jour font appel aux mobilités dites "douces" pour joindre un arrondissement à l’autre. On en a vu revêtir de peu seyantes camisoles en polyester aux couleurs criardes pour moins que ça…
Ainsi va la vie de l’automobiliste banlieusard dans le pays aux 34.935 communes -soit près de 40% de toutes celles que compte l’Union Européenne- quand l’exécutif local des plus puissantes d’entre elles promet de "rendre la ville à ses habitants" dans une logique de pré carré, et dans la totale indifférence des conséquences sur les municipalités environnantes de mesures restrictives à l’égard de l’automobile. Sur le territoire français cohabitent désormais les citoyens de Zones à Faibles Emissions et ceux d’un autre type de ZFE, qu’il faut sans doute comprendre implicitement de "Fortes Emissions". Ou du moins de trafic intense, quand on se soucie de déplacer le problème plutôt que de le résoudre. Mais après tout, qu’importe la périphérie quand l’égo de ceux prétendant sauver le monde se trouve satisfait ?
Alors de grâce, merci aux responsables véritablement responsables de renoncer à "rendre la ville à ses habitants" pour la rendre agréable à tous, qu’ils se déplacent à pied, à vélo, en tram ou en "six pot".