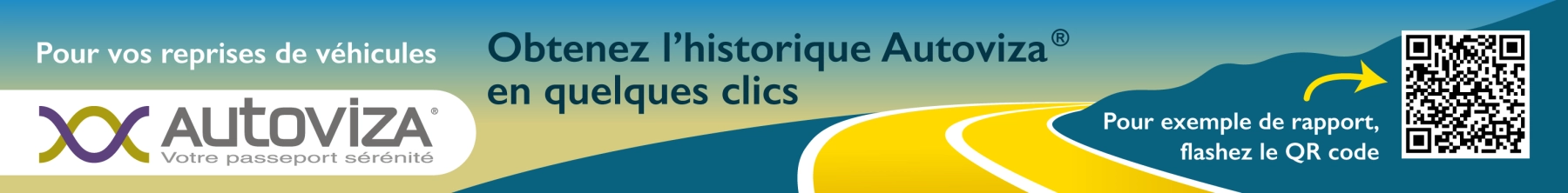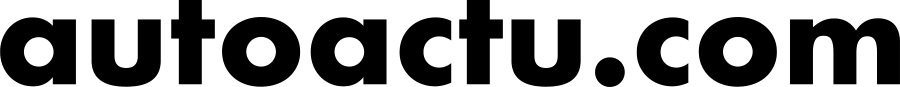24/04/2025 - #Peugeot
Vrais Faux-amis
Par Jean-Philippe Thery

Aujourd’hui je vous parle d’amis orthographiques ou pas, mais qui ne vous veulent pas que du bien…
Une vraie partie de yoyo.
Pendant plusieurs jours, le Président des Etats-Unis d’Amérique a remis au -mauvais- goût du jour celui qui constitue sans doute le plus ancien jouet de l’humanité après la toupie, pour les annoncer avant de les instituer puis les suspendre provisoirement, comme autant d’épées de Damoclès pointées vers la tête d’un certain nombre de dirigeants sommés de conclure un deal : Bref, Donald Trump a joué avec les tariffs.
Et non, mon doigt n’a pas dérapé sur le clavier. Parce que même si ce mot-là fleure bon notre terroir locutoire, les Anglosaxons ne se sont pas privés d’en dupliquer le « f » final, sans doute comme un pied de nez à notre belle orthographe dont tout le monde sait à quel point elle affectionne les lettres muettes. Sans compter que nos amis d’outre-Manche et Atlantique se fourrent gentiment le finger dans l’œil sur sa signification aussi, puisque tout le monde sait également qu’un tarif c’est un prix, et que par tariff , il faut comprendre « droits de douane ».
Ou pas. Le Dictionnaire de l’Académie française nous rappelle en effet que le terme trouve son origine dans le verbe arabe arrafa signifiant "informer, faire connaître" et qu’il a transité par l’italien tariffa avant d’arriver chez nous comme tariffe. Et surtout qu’il se définit comme un "tableau établi par une autorité, un organisme ou une personne habilités à le faire et indiquant le prix d’une chose, les frais dont il faut s’acquitter en échange d’un droit ou d’un service, etc". En résumé, le tarif est donc une liste et c’est par évolution métonymique - désignant le contenu par le tout- qu’il est devenu synonyme de prix, mais aussi de taxe. Tarif et tariffs sont donc un peu comme le Canada Dry (le voisin du nord l’ayant précisément un peu sec dans cette histoire), puisque s’ils ressemblent à de faux amis en associant similitude de forme et significations différentes, ils n’en possèdent pas moins une origine commune. A moins qu’on ne puisse les qualifier de "faux-amis partiels" (si, ça existe), ce que certains linguistes ne manqueront néanmoins pas de considérer comme controversable.
Quoiqu’il en soit, c’est un peu pareil dans la « vraie » vie.
Prenez par exemple le Brésil, où le gouvernement a récemment fait l’objet de véhémentes critiques pour avoir institué ce qu’un peuple à la linguistique particulièrement imagée a très vite désigné comme "taxa das blusinhas". Autrement dit la "taxe des petits corsages" en référence à la nature textile d’une part substantielle des articles vendus à bas prix par de grands sites de distribution en ligne venus d’orient. Les mêmes qui jusqu’ici échappaient aux fourches caudines de l’administration fiscale, ainsi qu’aux 60% de droits de douane redevables sur les articles dépassant 50 dollars. Une perte désormais compensée par les 20% d’impôt institués par la "taxa", auxquels s’ajoutent 17% d’ICMS (Impôt sur la Circulation des Marchandises et Services) perçus par l’Etat de destination (le Brésil est un pays fédéral).
De quoi nous rappeler que le Brésil est l’un des pays les plus protectionnistes parmi les grandes démocraties de la planète, et pas seulement pour ce qui est des chemisiers commandés en ligne. Pour la plupart des biens disponibles sur place, on a en effet souvent le choix entre "nacional" et "importado", autrement dit entre un produit moins cher -ce qui ne signifie pas nécessairement bon marché-, pas toujours du dernier cri et d’une qualité variable, et son équivalent moderne de meilleure facture mais significativement plus cher, et dont l’approvisionnement en pièces détachées n’est pas garanti en cas de pépin. Evidemment, je simplifie à outrance, puisqu’on trouve aussi des produits locaux tout à fait respectables comme de la quincaillerie venue d’ailleurs. Mais vous avez compris l’idée.
Et pour les voitures, c’est le même topo. Pour rouler en "importée" au pays du foot et de la Samba (alerte "clichés" déclenchée) , il faut en effet s’acquitter d’une somme affectée par 35% de droits de douanes, auxquels s’ajoutent un Impôt sur les Produits Industriels (IPI) à ’un taux "préférentiel" de 30% au lieu des 7 à 25% -en fonction de leur cylindrée- affectant les modèles issus des usines locales. Un traitement qui pousse la plupart des "montadoras" (constructeurs) à n’importer que les versions les mieux dotées de leurs modèles haut de gamme, histoire de les distinguer autrement que par un tarif hypertrophié par les tariffs. Et si le montant total figurant sur l’autocollant de parebrise ne s’avère pas suffisamment dissuasif, les candidats à l’achat doivent encore prévoir un coût d’entretien généralement exorbitant, quand il ne s’agit pas d’attendre parfois très longtemps des pièces à la disponibilité aléatoire. Une mésaventure vécue avec ma Citroën C5 de fonction pour laquelle il ne fut guère aisé de trouver une paire de pneus suite à une rencontre malencontreuse avec un de ces nids de poule dont l’asphalte brésilien a le secret, quand bien même je travaillais pour la marque.
Le résultat, c’est que 84% des voitures vendues au Brésil en 2024 ont été fabriquées dans le pays. Et encore doit-on tenir compte du fait que les importations de l’année dernière incluaient un nombre conséquent de véhicules venus de Chine, dont on sait que les constructeurs déstockent une partie de leurs surplus à l’étranger, y compris sur un certain nombre de marchés sud-américains. Quoiqu’il en soit, quatre voitures sur cinq d’origine nationale représente une proportion inconnue chez nous depuis bien longtemps, ce qui ne manquera pas de caresser dans le sens de la fibre les plus nationalistes des automobilistes. Lesquels feront sans doute remarquer non sans raison que si le Brésil levait d’un seul coup ses protections douanières, il porterait un coup probablement fatal à une industrie dont les chaines ont assemblé pas loin de 2,4 millions de véhicules légers l’année dernière, après avoir fleurté avec les 3,5 millions d’unités en 2012, alors qu’elle était au mieux de sa forme.
Ce serait pourtant ignorer que les mesures visant à protéger le pays des importations mises en place depuis plusieurs décennies comportent aussi leur lot de conséquences néfastes, la moindre d’entre elles n’étant pas de compliquer sérieusement la production autochtone, considérant que pour être labellisé "national" un véhicule produit dans le pays doit comporter au moins 60% de contenu local. Si la plupart des modèles venant des constructeurs historiques dépassent souvent ce quota, il n’en reste pas moins que les automobiles brésiliennes comportent également des pièces venues d’ailleurs, elles aussi dûment taxées et subissant parfois aux frontières le genre de tracasserie administrative qui rend les flux industriels plus tendus que nécessaire. Sans compter l’énorme travail de documentation destiné à prouver l’origine des différents composants, sous forme de certificats émanant de fournisseurs eux-mêmes soumis aux mêmes contraintes, profondeur d’intégration exige.
Mais surtout, protectionnisme et compétitivité ne vont pas vraiment de pair lorsque cantonnée à la portion congrue du marché, la concurrence venue de l’étranger n’en est plus vraiment une. Ce qui explique pourquoi le Brésil n’a jamais pu exporter plus d’un tiers de sa production de véhicules légers, proportion qu’il n’a d’ailleurs atteinte que lors de ses meilleures années. En 2024, à peine 16% d’entre eux sont en effet allés voir du pays, alors que cette proportion atteignait 87% au Mexique. Et encore la majorité des exportations brésiliennes découlent-elles d’un accord bilatéral avec l’Argentine, auquel le Brésil vend essentiellement de petites voitures alors que des modèles plus gros fabriqués par les hermanos traversent la frontière dans l’autre sens.
Avec peu de débouchés extérieurs, c’est donc principalement sur le marché domestique que doivent compter les industriels pour rentabiliser un programme, lequel reste conséquent avec pas loin de 2,4 millions d’immatriculations (VP et VUL) en 2024, même si loin du record établi en 2012, un poil au-dessus de 3,6 millions d’unités. Pour maintenir un prix accessible à la clientèle brésilienne de voitures neuves, il faut donc impérativement passer par la case "decontenting", résultant dans une définition moins riche que celle du modèle équivalent construit en Europe, en Amérique du nord, au Japon ou en Corée. Et quand ça ne suffit pas, il faut parfois se résoudre à maintenir le même modèle sur l’équivalent de deux générations, avec un restylage local low-cost alors que celui-ci est totalement renouvelé dans son pays d’origine. Un exemple de modèle "long life" fut la "fausse 207" conçue par Peugeot et vendue dans nos contrées comme "206+", qui coûta très cher en image à la marque au lion, accusée de duperie par des clients brésiliens d’autant plus fâchés que la (vraie) 206 avait signifié exactement l’inverse à son lancement, quand elle apportait la nouveauté européenne sur un marché ne proposant alors que des modèles dépassés.
Voilà le genre de cercle vicieux dans lequel enferment des "tariffs" se voulant protecteurs mais qui se montrent en réalité peu amicaux, lorsqu’ils contraignent les groupes automobiles à lancer des modèles trop spécifiques pour être exportables parce qu’adaptés au marché local. Sans compter leur coût de production trop élevé, l’absence de concurrence externe n’incitant guère à en améliorer la compétitivité, et les volumes de production étant limités par ceux…des exportations.
Et si je ne me lancerai pas dans le difficile exercice consistant à réécrire l’histoire en imaginant ce que serait aujourd’hui son industrie automobile sans protection tarifaire, il faut bien constater que le Brésil est aujourd’hui prisonnier d’un protectionnisme dont un pays comme la Corée du Sud a su se débarrasser progressivement, il est vrai incitée à aller voir ailleurs en raison de la taille réduite de son propre marché.
Quoiqu’il en soit, je doute que l’homme au yoyo ne s’intéresse jamais à ces exemples-là, ni à l’étymologie de ces tariffs dont il a réinventé le calcul. Reste à voir comment résistera le marché nord-américain à ces faux-amis-là, ou du moins à ce qui en subsistera…