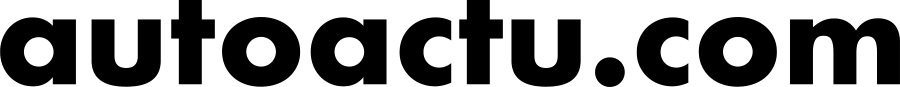23/03/2023 - #Tesla , #Ferrari , #Smart
Paris-Berlin...pas express
Par Jean-Philippe Thery

Cette semaine, je vous emmène en berline berlinoise. Un voyage dont vous imaginez probablement la destination…
Tout ça c’est la faute du train.
Sans le train, nous ne serions pas devenus navetteurs. Parce que c’est le chemin de fer qui a permis la séparation entre lieux de vie et de travail, et le développement des banlieues dans les années 40, celles du XIXe siècle et de la révolution industrielle, bien sûr. Et c’est dans les périphéries de villes comme Boston, Chicago et Philadelphie que sont apparus les "commuters", ces voyageurs du quotidien ainsi désignés en raison des tickets au tarif "commuted" qu’ils utilisaient, permettant de répéter le même trajet à moindre coût. Un anglicisme potentiel que nous ont évité les Belges, créateurs du "navettage", néologisme du début XXe faisant référence à l’"instrument en forme de barquette engageant la trame entre les fils de chaîne sur un métier à tisser, lequel se déplace dans un mouvement alternatif horizontal", autrement dit la navette.
Plus d’un siècle plus tard, le navettage constitue pour une majorité d’automobilistes l’usage principal de leur véhicule. Rien d’étonnant dans ces conditions, comme nous le rappelait l’INSEE en 2017, que 74 % des actifs en emploi qui déclarent se déplacer pour rejoindre leur lieu de travail utilisent leur voiture, loin devant les transports en commun (16%), la marche (6%), et le vélo (2%). Ce qui revient à dire que nous effectuons du cabotage aux commandes de transatlantiques -et même de supertankers pour certains- alors qu’une Smart ferait largement l’affaire dans la plupart des cas. Un raisonnement qu’affectionnent les adeptes de la moyenne, qui feignent néanmoins d’ignorer que pour l’acheteur, c’est par l’usage maximal que se définit le cahier des charges d’une voiture.
Karl se fiche pas mal de ces statistiques, lui qui n’a jamais connu l’ennui de trajets domicile-travail répétitifs, du moins depuis qu’on roule ensemble. Ceux qui me lisent régulièrement se rappelleront que je prénomme mes voitures au masculin, depuis que mon épouse lusophone m’a expliqué qu’une bagnole, c’est un mec, et qu’il ne saurait y avoir chez nous deux prénoms féminins, quand bien même l’un d’entre eux résiderait au garage. Quoiqu’il en soit, c’est "le" Mercedes C200K 2006 que j’ai acquis l’année dernière à Berlin qui nous a fait traverser l’Allemagne pour rejoindre Paris où je comptais lui trouver un nouveau foyer. Sauf qu’ayant depuis réemménagé dans la capitale allemande, je me suis récemment décidé à l’y faire revenir.
1072 km. C’est la distance séparant très exactement sur le papier -ou plutôt sur l’écran de mon portable- le garage de banlieue où j’avais laissé Karl de mon domicile situé dans le quartier occidental de Friedrichshain. Mille bornes, c’était aussi la perspective d’un voyage en solitaire qui me réjouissait autant que mes amis celle de voir leur cave enfin débarrassée des cartons que j’y avais progressivement accumulés, commençant par le nord de l’Hexagone avant une traversée rapide de la Belgique d’Ouest en Est, puis la promesse de portions d’autobahn libérées de la surveillance inquiète du tachymètre.
Sauf que ça ne s’est évidemment pas passé comme prévu. A commencer par un départ sans cesse repoussé par faute des fameux cartons qu’il m’a fallu récupérer puis réorganiser, et de plein de trucs de dernière minute qui m’ont tenu jusqu’à l’heure du repas. Et comme je n’ai pas su résister à une amicale invitation à déjeuner, j’ai donc remis au début d’après-midi l’inévitable embouteillage de l’A86. Puis ce fut la réunion en distanciel sur une aire de l’A1, et l’incursion tardive dans un supermarché de Cambrai afin de ramener de tendres et chers délices de France à ma chère et tendre épouse, même si j’ai commis l’incroyable bourde d’oublier les Bêtises. Bref, la nuit se pointait déjà quand j’approchai de Charleroi, et c’est justement en Belgique qu’elle me rattrapa : une neige dense, du genre qui tient à l’asphalte et qui ne devait plus me lâcher jusqu’à l’arrivée.
D’habitude, j’adore conduire sur la neige. Mais d’habitude, je ne roule pas de nuit sur l’autoroute au volant d’une propulsion équipée de pneumatiques toutes saisons, à 800 km de mon point de destination. Bon, je reconnais m’être tout de même bien amusé à la sortie des aires de repos et stations-service désertées, à faire déboiter l’arrière à 50 km /h sur la poudreuse, antipatinage et correcteur de trajectoire débranchés, puis rebranchés "pour voir". Et je suis au regret d’informer Ferrari que Karl disposait déjà il y a 17 ans de sa propre version du "Slide Slip Control", son électronique permissive autorisant une belle amorce de dérive avant de reprendre les choses en main.
Pour le reste, je n’ai guère fait le malin. L’antipatinage/ESP ne s’est d’ailleurs involontairement déclenché qu’une seule fois, sur une voie d’accès à l’Autobahn abordée avec trop d’enthousiasme. Un léger déhanchement du postérieur plus tard, tout était néanmoins rentré dans l’ordre, le clignotement orange émanant du bloc instrumentation me rappelant que les puces électroniques veillaient sur Karl et son occupant. Le reste du temps, c’est dans l’articulation du genou droit que j’ai branché mes propres aides à la conduite, bien aidées par une course d’accélérateur particulièrement longue, calibrée pour un conducteur chaussant du 48 ou plus. Parce que si je me rêve volontiers en pilote sur petites routes dégagées à basse vitesse, je ne me vois pas rattraper d’éventuelles incartades du train arrière sur autoroute. Quand on n'est pas suffisamment expert, mieux vaut rester en dessous de ce qu’on croit constituer les limites de son auto…
Evidemment, ça aurait été plus simple si j’avais été tout seul. Mais pour dépasser les nombreux camions et autres véhicules assurant le nettoyage de la file de droite, il m’a bien fallu m’aventurer sur celle du milieu, moins fréquentée et donc parsemée de plaques blanches au coefficient d’adhérence douteux. Autant dire qu’en de telles circonstances, en remontant lentement les tonnes d’acier en mouvement des semi-remorques, on développe une hyper-sensibilité aux mouvements de lacets, dont on se demande en permanence ce qui les provoque de la chaussée glissante ou de son imagination, alors que les flocons se précipitant dans la nuit sur le parebrise créent un effet d’optique tunnelisant, avant de s’écraser silencieusement sur le verre balayé par les essuie-glaces. Une ambiance qui sollicite d’autant plus la concentration et la rétine qu’il fait noir, et même très noir sur les autoroutes allemandes, mais aussi belges depuis qu’en octobre dernier, la Wallonie éteint par souci d’économie les 20 à 25.000 lampadaires qui faisaient pourtant leur réputation.
Heureusement pour moi, Karl dispose évidemment du meilleur ami de l’automobiliste esseulé, même si après avoir dépassé la zone de réception de l’unique station préréglée, j’ai vécu des aventures musicales pas toujours choisies, que ce soit par la flemme de toucher aux commandes du son ou parce que mon attention était tout entière dédiée à la conduite. L’unique radio syntonisée en Belgique m’a ainsi offert une rétrospective de tubes sixties dont je ne connaissais pas la moitié, suivie d’une session de métal dont le pays est semble-t-il grand spécialiste. Toujours est-il que l’unique CD dont je disposai est curieusement resté dans le bac de portière, sans doute parce qu’"Autobahn" de Kraftwerk aurait été plus adapté aux circonstances que les Pink Floyd. Mais j’ai tout de même eu le temps d’essayer de me remémorer ce que signifiaient les sigles RDS, TA et TP parsemant l’écran LCD, l’un d’entre eux correspondant forcément aux inquiétantes alertes interrompant régulièrement le flot musical, et faisant systématiquement référence à un "Unfall" (accident).
Je dois pourtant à l’un d’entre eux ce qui a constitué le point d’orgue du voyage, après que le GPS m’a proposé de quitter la voie rapide pour un chemin supposée l’être plus encore. Si à trois ou quatre cents kilomètres du but, je n’avais en principe aucune envie d’une excursion donnant le sentiment de retarder d’autant mon heure d’arrivée, l’impatience le céda bientôt à l’enchantement, à contempler les paysages qui s’offraient à moi. J’appris plus tard et encore par la radio, que j’avais échangé une heure d’embouteillage contre la traversée magique de sous-bois recouverts d’un épais manteau blanc et de villages endormis.
En retrouvant l’autoroute, je savais déjà que j’irais jusqu’au bout, échangeant la nuit d’hôtel pas cher du plan initial contre de nombreux arrêts en station-service. J’en fus quitte pour une salade de pâtes dans un récipient en plastique mais sans les conséquences intestinales que l’excès d’épices laissait à craindre, plusieurs cafés distillés par des machines aux écrans de commande le disputant à ceux d’une Tesla, deux bouteilles d’eau minérale aromatisée au citron et un paquet de petits beurres acheté en France. De quoi me rappeler que l’indigence gastronomique est sans doute la seule chose que partagent les voyages aériens et les trajets autoroutiers…
L’éphéméride de ce jour-là indique que le soleil se leva à 6h33. Mais c’est un peu avant, alors que pointaient les premières lueurs du jour que je ressentis ce sentiment victorieux procuré par la sortie de la nuit. Avec le manque de sommeil et la fatigue qui finit tout de même par se manifester, il s’en est fallu de peu pour que je ne m’identifie à ces pilotes des 24 heures qui voient poindre l’aube comme une délivrance. Quoiqu’il en soit, j’ai coupé le moteur pour de bon à 6h50 avec un sentiment de mission accomplie, au terme d’un périple épique de 1110 km réalisés en 16h26, dont 13h12 au volant. Et si les modestes 84 km/h de moyenne témoignent des conditions adverses que j’ai rencontrées, ça ne devrait pas m’empêcher de recevoir bientôt une photo souvenir, du moins si j’en crois la vive lumière qui m’a fait sursauter dans une zone à 100 km/h où je me suis "oublié" à 110.
J’ai depuis retrouvé mon train-train quotidien de navetteur ferroviaire, sur la ligne M10 du Tramway berlinois. Mais en déposant Karl hier matin au parking du bureau histoire de ne pas le laisser trainer dans la rue, je n’ai pu m’empêcher de me retourner sur sa carrosserie, exhibant les salissures du trajet comme un trophée. Et même si nous ne devrions pas de sitôt passer une nouvelle nuit blanche, je me suis quand même demandé : A quand notre prochain voyage ?